Le premier antibiotique qui n’a pas fonctionné pour Debbi Forsythe était le triméthoprime. En mars 2016, Forsythe, une géniale conseillère en soins primaires de Morpeth, dans le Northumberland, a contracté une infection urinaire. Les infections urinaires sont courantes : plus de 150 millions de personnes dans le monde en contractent une chaque année. Lorsque Mme Forsythe a consulté son médecin généraliste, celui-ci lui a prescrit le traitement habituel : une cure d’antibiotiques de trois jours. Lorsque, quelques semaines plus tard, elle s’est évanouie et a commencé à perdre du sang, elle a revu son généraliste, qui lui a de nouveau prescrit du triméthoprime.
Trois jours après, Pete, le mari de Forsythe, est rentré chez lui pour trouver sa femme allongée sur le canapé, tremblante, incapable d’appeler à l’aide. Il l’a emmenée d’urgence à l’A&E. Elle a été mise sous un second antibiotique, la gentamicine, et traitée pour une septicémie, une complication de l’infection qui peut être fatale si elle n’est pas traitée rapidement. La gentamicine n’a pas fonctionné non plus. Les médecins ont envoyé le sang de Forsythe pour qu’il soit analysé, mais de tels tests peuvent prendre des jours : les bactéries doivent être cultivées, puis testées contre plusieurs antibiotiques pour trouver un traitement approprié. Cinq jours après son admission à l’hôpital, on a diagnostiqué chez Forsythe une infection à E coli multirésistante, et on lui a administré de l’ertapenem, l’un des antibiotiques dits de « dernier recours ».
Cela a marché. Mais les dommages causés par l’épisode de Forsythe ont persisté et elle vit dans la crainte constante qu’une infection se reproduise. Six mois après son effondrement, elle a développé une autre infection urinaire, ce qui a entraîné un nouveau séjour à l’hôpital. « J’ai dû accepter le fait que je ne pourrai plus revenir à mon état antérieur », dit-elle. « Ma fille et mon fils m’ont dit qu’ils avaient l’impression d’avoir perdu leur maman, parce que je n’étais plus ce que j’étais avant ». Mais Forsythe a eu de la chance. La septicémie tue actuellement plus de personnes au Royaume-Uni que le cancer du poumon, et ce nombre augmente, car nous sommes de plus en plus nombreux à développer des infections immunisées contre les antibiotiques.
La résistance aux antimicrobiens (RAM) – le processus par lequel les bactéries (et les levures et les virus) développent des mécanismes de défense contre les médicaments que nous utilisons pour les traiter – progresse si rapidement que l’ONU l’a qualifiée d' »urgence sanitaire mondiale ». Chaque année, au moins 2 millions d’Américains contractent des infections résistantes aux médicaments. Les soi-disant « superbactéries » se propagent rapidement, en partie parce que certaines bactéries sont capables d’emprunter des gènes de résistance aux espèces voisines via un processus appelé transfert horizontal de gènes. En 2013, des chercheurs chinois ont découvert des E coli contenant mcr-1, un gène résistant à la colistine, un antibiotique de dernière ligne qui, jusqu’à récemment, était considéré comme trop toxique pour l’usage humain. Des infections résistantes à la colistine ont maintenant été détectées dans au moins 30 pays.
« En Inde et au Pakistan, au Bangladesh, en Chine et dans des pays d’Amérique du Sud, le problème de la résistance est déjà endémique », déclare Colin Garner, PDG d’Antibiotic Research UK. En mai 2016, le Review on Antimicrobial Resistance du gouvernement britannique prévoyait que, d’ici 2050, les infections résistantes aux antibiotiques pourraient tuer 10 millions de personnes par an – plus que tous les cancers réunis.
« Nous avons de bonnes chances d’arriver à un point où, pour beaucoup de gens, il n’y a plus d’antibiotiques », m’a dit Daniel Berman, responsable de l’équipe Global Health chez Nesta. La menace est difficile à imaginer. Un monde sans antibiotiques signifierait le retour à une époque où il n’y avait pas de transplantations d’organes, pas de prothèses de hanche, pas de nombreuses opérations chirurgicales aujourd’hui courantes. Cela signifierait que des millions de femmes supplémentaires mourraient en couches, que de nombreux traitements contre le cancer, y compris la chimiothérapie, seraient impossibles et que même la plus petite blessure pourrait mettre la vie en danger. Comme me l’a dit Berman : « Ceux d’entre nous qui suivent cela de près sont en fait assez effrayés. »
Les bactéries sont partout : dans nos corps, dans l’air, dans le sol, recouvrant chaque surface par sextillions. De nombreuses bactéries produisent des composés antibiotiques – combien exactement, nous ne le savons pas – probablement comme des armes dans une bataille microscopique pour les ressources entre différentes souches de bactéries qui se déroule depuis des milliards d’années. Comme les bactéries se reproduisent très rapidement, elles sont capables d’évoluer à une vitesse étonnante. Il suffit d’exposer une bactérie à une concentration suffisamment faible d’un antibiotique pour qu’une résistance apparaisse en quelques jours. La résistance à la pénicilline a été documentée pour la première fois en 1940, un an avant sa première utilisation chez l’homme. (Une idée fausse très répandue est que les gens peuvent devenir résistants aux antibiotiques. Ce n’est pas le cas – les bactéries le font.)
« Les antibiotiques n’existent que depuis 70 ou 80 ans. Les insectes sont sur cette planète depuis 3 milliards d’années. Et ils ont donc développé toutes sortes de mécanismes de survie », explique Garner.
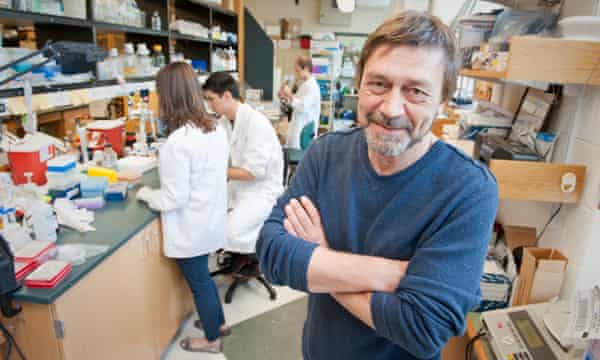
Le problème est qu’aujourd’hui, les antibiotiques sont aussi partout. Une personne sur trois se voit prescrire un traitement antibiotique chaque année, dont un cinquième inutilement, selon Public Health England. Pendant des décennies, de nombreux agriculteurs ont injecté des antibiotiques au bétail, autant pour l’engraisser que pour prévenir les infections (cette pratique est désormais interdite dans l’UE, aux États-Unis et au Canada). « Notre génération est fascinée par les pouvoirs des antibiotiques », déclare Jim O’Neill, l’économiste à l’origine de la révision gouvernementale. « Le problème est que nous les utilisons pour des choses dont nous ne devrions pas avoir besoin. »
Dans les premières décennies des antibiotiques, la résistance n’était pas un problème grave – il suffisait de trouver un nouveau médicament. Après que la pénicilline a révolutionné les soins de santé sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, l’industrie pharmaceutique s’est lancée dans un âge d’or de la découverte d’antibiotiques. Les entreprises ont fait appel à des explorateurs, des missionnaires et des voyageurs du monde entier pour rapporter des échantillons de sol à la recherche de nouveaux composés. La streptomycine a été découverte dans un champ du New Jersey ; la vancomycine, dans les jungles de Bornéo ; les céphalosporines dans une bouche d’égout en Sardaigne.
Mais l’âge d’or a été de courte durée. Les nouvelles découvertes se sont ralenties. Les composés antibiotiques sont courants dans la nature, mais ceux qui peuvent tuer les bactéries sans nuire aux humains ne le sont pas. Bientôt, les grandes entreprises pharmaceutiques ont commencé à réduire le financement de leurs départements de recherche sur les antibiotiques, avant de les fermer complètement.
« La réalité est que le secteur privé n’investit pas suffisamment pour soutenir la nouvelle recherche et le développement », déclare Tim Jinks, responsable du programme sur les infections résistantes aux médicaments au Wellcome Trust. Le problème est d’ordre économique : dans l’idéal, les antibiotiques devraient être bon marché, mais aussi utilisés le moins possible. Ce n’est pas une bonne proposition commerciale. Et comme la résistance aux antibiotiques peut apparaître dès l’année qui suit l’introduction d’une nouvelle classe, un nouvel antibiotique pourrait n’avoir qu’une durée de vie effective de 10 à 15 ans – à peine suffisante pour rentabiliser des années de développement. « Les chiffres ne s’additionnent tout simplement pas », dit-il.
Il y a encore de l’espoir. Début 2015, des chercheurs de l’Université Northeastern dans le Massachusetts ont annoncé avoir découvert une nouvelle classe d’antibiotiques dans un champ du Maine. Appelée teixobactine, elle est produite par une bactérie récemment découverte, Eleftheria terrae, et efficace contre une série d’infections résistantes aux médicaments. La teixobactine a été découverte par Slava Epstein et Kim Lewis à l’aide d’une iChip, un dispositif ingénieux de la taille d’une puce USB conçu pour résoudre un problème qui contrarie les biologistes depuis des décennies : sur les milliards de bactéries présentes dans la nature, seul 1 % des espèces se développe dans une boîte de Pétri. « Nous avons imaginé un gadget simple », explique M. Lewis. « On prend des bactéries dans le sol, on les prend en sandwich entre deux membranes semi-perméables, et on piège essentiellement les bactéries ». Jusqu’à présent, le duo a identifié environ 80 000 souches jusqu’alors non cultivées à l’aide de ce dispositif, et a isolé plusieurs nouveaux antibiotiques encourageants.
La teixobactine est particulièrement prometteuse pour une raison simple : à ce jour, aucune bactérie n’a pu développer de résistance à son égard. « Lorsque nous avons publié l’article il y a quatre ans, un certain nombre de mes collègues m’ont écrit des courriels disant : « Envoyez-moi de la teixobactine, et je vous renverrai des mutants résistants » », dit Lewis. « J’attends toujours. »
Ishwar Singh se souvient du moment où il a entendu parler de la teixobactine : « C’était le 7 janvier 2015, sur la BBC », dit-il. Lecteur à l’école de pharmacie de l’université de Lincoln, Singh est spécialisé dans le développement de nouveaux médicaments. La nouvelle l’a fasciné. « La plupart des antibiotiques ciblent les protéines. La teixobactine agit sur un lipide – l’élément constitutif de la paroi cellulaire », explique-t-il. Elle attaque simultanément de plusieurs façons, ce qui rend la résistance impossible, du moins jusqu’à présent. Singh secoue la tête avec admiration. « La nature a construit une si belle molécule. »

Aujourd’hui, Singh dirige l’une des nombreuses équipes dans le monde qui développent la teixobactine. Je le rencontre par une matinée humide de janvier dans son laboratoire, où il porte des lunettes sans monture et affiche une expression de grand optimisme. Sur une paillasse, Singh a dessiné la structure chimique de la teixobactine avec des marqueurs multicolores. Des chercheurs postdoctoraux s’affairent à tester la pureté d’échantillons. Un étudiant en doctorat brandit un minuscule flacon contenant une poudre blanche fine de l’épaisseur d’un ongle. « C’est la teixobactine », dit M. Singh.
Au début, la production d’une si petite quantité s’est avérée difficile. Puis, en mars de l’année dernière, l’équipe de Singh a fait une percée significative : elle a remplacé un acide aminé difficile à produire par un autre, disponible à bas prix. « Il n’y avait pas grand-chose à perdre, car les gens disaient déjà que cela ne marcherait pas », explique-t-il. Mais cela a marché : les tests ont montré qu’il était efficace contre les infections chez les souris. Singh estime que la nouvelle structure réduira le coût de production de 200 000 fois.
Néanmoins, la teixobactine est encore loin d’être testée chez l’homme. Sa mise sur le marché pourrait prendre une décennie ou plus, si elle fonctionne. D’autres nouveaux médicaments sont plus avancés : la zoliflodacine, destinée à traiter la gonorrhée Neisseria multirésistante, est actuellement en phase trois des essais sur l’homme. En 2016, poussés par la crise croissante, les États-Unis, le Royaume-Uni et des organisations caritatives, dont le Wellcome Trust, ont lancé l’initiative CARB-X, offrant 500 millions de dollars de financement pour de nouveaux antibiotiques prometteurs. Grâce à des techniques comme le séquençage rapide des gènes et la métagénomique – qui recherche de l’ADN prometteur dans l’environnement, puis le clone dans de nouvelles bactéries – les scientifiques ont récemment découvert toute une série de nouveaux composés prometteurs, dont un trouvé à l’intérieur du nez humain. « Les choses bougent, ce qui est une bonne chose », déclare M. Lewis. « Mais c’est un petit filet d’eau. »
Compte tenu de l’urgence du problème, d’autres adoptent des approches plus pragmatiques. L’une des plus prometteuses est peut-être la plus simple : donner aux patients plus d’un médicament à la fois. « Tout ce que nous utilisons pour les infections courantes est une monothérapie », explique Anthony Coates, professeur de microbiologie médicale à l’hôpital universitaire St George de Tooting, à Londres. En revanche, la thérapie combinée – qui consiste à utiliser plusieurs médicaments complémentaires de concert – est la norme dans de nombreux autres domaines. « Le sida en est un, l’oncologie en est un autre », explique-t-il. « Pourquoi ne le faisons-nous pas avec les bactéries communes ? »
Je le rencontre à son domicile à Londres. Il a un comportement calme et réfléchi, ce qui rend son inquiétude d’autant plus alarmante. « La RAM est un désastre », dit-il. « Nous voyons cette détérioration se produire plus rapidement que je ne l’aurais jamais imaginé. »
La spécialité de Coates est ce qu’on appelle les briseurs de résistance aux antibiotiques – des composés qui, appliqués en combinaison, peuvent rendre les bactéries résistantes aux médicaments à nouveau sensibles aux antibiotiques. En 2002, il a créé une société, Helperby Therapeutics, pour mettre au point des médicaments combinés ; plusieurs d’entre eux font actuellement l’objet d’essais cliniques. « Nous recherchons des milliers de combinaisons », explique-t-il. Jusqu’à récemment, le travail était lent et laborieux, effectué à la main, mais les progrès de la robotique et de l’IA permettent aujourd’hui d’automatiser une grande partie du travail, ce qui a permis des combinaisons plus complexes.
La raison exacte pour laquelle les thérapies combinées fonctionnent n’est pas toujours claire. « Nous comprenons certains des deux : vous avez un insecte, vous faites des trous avec un antibiotique, puis cela permet au deuxième antibiotique d’entrer », explique Coates. « Quand vous en avez trois qui agissent ensemble, c’est plus compliqué. Quatre et cinq : très compliqué. » Mais la façon dont les combinaisons fonctionnent n’est pas aussi importante que le fait qu’elles fonctionnent.
Un avantage de la thérapie combinée est que beaucoup des médicaments que Helperby passe au crible ont déjà subi les essais cliniques approfondis nécessaires avant de pouvoir être administrés aux patients – « probablement des millions de personnes » – de sorte que la probabilité que les médicaments échouent aux essais sur l’homme est plus faible.
Les nouveaux médicaments seuls ne résoudront pas le problème de la résistance. « Oui, il est important d’avoir de nouveaux médicaments, mais cela ne fait que gérer le problème pour une autre génération », dit O’Neill. Ce n’est pas un médicament qui a permis de maîtriser l’épidémie de SARM, mais une meilleure hygiène hospitalière : le lavage des mains. Le plus grand souhait de M. O’Neill n’est pas du tout un traitement. Si on me disait : « Vous ne pouvez avoir qu’une seule chose », ce serait des diagnostics de pointe pour réduire l’utilisation inappropriée », dit-il.
Diagnostiquer si une maladie est causée par une bactérie ou un virus est l’une des tâches les plus courantes des médecins, mais elle est diaboliquement difficile. Les symptômes se chevauchent. « Les tests de diagnostic traditionnellement utilisés par les médecins prennent beaucoup de temps et sont complexes », explique Cassandra Kelly-Cirino, directrice des menaces émergentes à la Fondation pour les nouveaux diagnostics innovants, basée à Genève. « La plupart des médecins vont pécher par excès de prudence et donner des antibiotiques, même si le patient pourrait en fait avoir un virus. » Face à des patients insistants et désespérés de se sentir mieux, il est souvent plus facile (et moins cher) de prescrire un traitement de pénicilline, qu’il soit nécessaire ou non.
En 2014, dans le but de développer des tests de diagnostic inédits et accessibles, le gouvernement britannique a lancé le Longitude Prize, doté de 8 millions de livres sterling, qui suit aujourd’hui 83 équipes dans 14 pays. « Certains des projets sont vraiment innovants », déclare Daniel Berman, de Nesta, qui dirige l’équipe de juges. Un groupe australien utilise l’IA pour étudier les tendances des tests sanguins afin de prédire la septicémie. Une équipe de Pune, en Inde, a mis au point un test ingénieux de la taille d’une carte de crédit, appelé USense, pour dépister les infections urinaires. « Vous mettez un échantillon d’urine dedans, et il vous dit lequel des quatre antibiotiques serait sensible », explique Berman. Les résultats prennent 60 minutes. En cas de succès, le test USense pourrait aider à prévenir des cas comme celui de Debbi Forsythe, dans lequel un diagnostic plus rapide aurait pu éviter la septicémie.
S’attaquer à la résistance aux antibiotiques nécessitera de tels efforts internationaux. Quelque 90 % des décès prévus dus à la RAM auront lieu en Afrique et en Asie – les pays où la surconsommation d’antibiotiques, et les infections résistantes, sont les plus élevées. Lorsque l’étude sur la RAM a été publiée en 2016, M. O’Neill a été encouragé par la réponse internationale. Mais depuis, le Brexit et l’administration Trump ont fait disparaître la RAM de l’actualité. Et malgré les discours enthousiastes, les entreprises pharmaceutiques continuent de faire du sur-place.
« Je pense parfois que les PDG des entreprises pharmaceutiques se disent : « Nous allons attendre que cela devienne une vraie crise », dit O’Neill.
{{topLeft}}
{bottomLeft}
{topRight}
{bottomRight}
.
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphes}}{{texte mis en évidence}

- Partager sur Facebook
- Partager sur Twitter
- Partager par courriel
- Partager sur LinkedIn
- Partager sur Pinterest
- Partager sur WhatsApp
- Partager sur Messenger
.